Communauté vs communautarisme : comment trouver le bon équilibre ?

Identify your target audience
Pretium eget enim ut bibendum ac rutrum hendrerit risus vitae non morbi phasellus sollicitudin luch venenatis tortor massa porttitor diam auctor arcu cursus sit mauris scelerisque orci aliquam amet nascetur lectus tempus nunc tortor sed enim fermentum tincidunt quis erat nibh interdum cum tristique tincidunt cursus malesuada amet ac feugiat aliquam tellus non.
- Donec ornare scelerisque sit ut dictumst sed vulputate amet quam bibendum.
- Varius at malesuada mi aliquet proin eu condimentum aliquam tincidunt ac elit.
- Viverra et et non facilisis congue orci purus feugiat morbi sapien pharetra pellentesqe.
- At a massa ante pharetra ultricies libero enim nulla tristique lacus sed.

Implement lead
Mus mauris donec consectetur nisl ultricies. Malesuada integer augue sed ullamcorper condimentum malesuada mauris vulputate integer. Sit fermentum sit orci sit velit pulvinar sed. Nunc leo sed diam ornare felis magna id vitae urna. Scelerisque gravida eget at pellentesque morbi amet vitae elit volutpat. Pretium in gravida vel nascetur platea dictum parturient laoreet.
Why Identifying Your Target Audience is Key to Success
Sit fermentum sit orci sit velit pulvinar sed. Nunc leo sed diam ornare felis magna id vitae urna. Scelerisque gravida eget at pellentesque morbi amet vitae elit volutpat. Pretium in gravida vel nascetur platea dictum parturient laoreet.
- Elit venenatis suscipit mus nec mauris et purus egestas imperdiet mauris.
- Amet nisl nisl proin praesent orci pellentesque eu egestas eu scelerisque ipsum.
- Viverra nulla id lobortis ut sollicitudin aenean arcu volutpat non suspendisse.
- Volutpat risus ut suscipit nec pretium libero nulla lacus vitae donec facilisis.
Tailoring your message to your target audience
Id integer amet elit dui felis eget nisl mollis in id nunc vulputate vivamus est egestas amet pellentesque eget nisi lacus proin aliquam tempus aliquam ipsum pellentesque aenean nibh netus fringilla blandit dictum suspendisse nisi gravida mattis elementum senectus leo at proin odio rhoncus adipiscing est porttitor venenatis pharetra urna egestas commodo facilisis ut nibh tincidunt mi vivamus sollicitudin nec congue gravida faucibus purus.
“Dignissim ultrices malesuada nullam est volutpat orci enim sed scelerisque et tristique velit semper.”
The role of demographics in identifying your target audience
Id integer amet elit dui felis eget nisl mollis in id nunc vulputate vivamus est egestas amet pellentesque eget nisi lacus proin aliquam tempus aliquam ipsum pellentesque aenean nibh netus fringilla blandit dictum suspendisse nisi gravida mattis elementum senectus leo at proin odio rhoncus adipiscing est porttitor venenatis pharetra urna egestas commodo facilisis ut nibh tincidunt mi vivamus sollicitudin nec congue gravida faucibus purus.
Créer une communauté est souvent présenté comme la promesse ultime du lien social retrouvé. Et c’est vrai : dans un monde hyper-fragmenté, faire émerger des espaces où l’on partage les mêmes valeurs, les mêmes codes, les mêmes références, c’est précieux. On y retrouve ce truc devenu un peu rare ces derniers temps, qu’on appelle le sentiment d’appartenance. Mais si on pousse la réflexion un cran plus loin, une autre question émerge, un peu moins confortable : et si ce besoin d’appartenance venait parfois nourrir… l’entre-soi ? La communauté est-elle vouée à créer une forme de communautarisme ?
Le politologue Jérôme Fourquet, dans L’Archipel français, parle justement de la société française comme d’un ensemble d’îlots qui ne se parlent plus, ou très peu. Des groupes homogènes, aux imaginaires qui ne se répondent plus, aux récits qui ne s’écoutent plus. On ne vit plus vraiment ensemble, on vit côte à côte, chacun sur son île.
Et c’est là que ça devient intéressant – voire un peu vertigineux – pour les Community Builders. Parce que cet espace que l’on construit peut être à la fois un formidable outil de lien… ou un accélérateur de repli. Des bulles qui soudent ceux qui sont à l’intérieur.. mais aussi des bulles qui isolent du reste du monde.
Alors, on a voulu poser la question franchement : comment éviter que nos communautés ne deviennent des caisses de résonance ? Comment rester ouverts, curieux, connectés aux autres ? Comment faire de la communauté un tremplin vers l’extérieur, plutôt qu’un refuge en vase clos ?
Dans cet article, on vous propose de creuser cette tension entre lien et fermeture, entre cohésion et isolement. Et surtout, on partage des pistes concrètes pour bâtir des ponts plutôt que des murs.
Communauté et communautarisme : les liaisons dangereuses
Chez The Storyline, on adore les communautés, ça va de soi ! Ce sont des espaces d’entraide, de créativité, de lien. Mais, comme souvent, ce qui fait la force d’un modèle peut aussi devenir sa plus grande faille.
Créer une communauté, c’est aussi prendre le risque — si on n’y prend pas garde — d’alimenter des logiques d’entre-soi, de radicalisation douce, voire de dérive toxique. On connaît déjà bien les concepts de bulles de filtres ou de chambres d’écho, très documentés, qui transforment les réseaux sociaux en amplificateurs d’une pensée unique (et très limitée).
C’est l’effet pervers d’algorithmes conçus pour proposer aux internautes un contenu qui répond à leurs intérêts, mais qui enferme chacun dans ses convictions, et montre à chaque individu uniquement ce qu’il ou elle a envie de voir. Les communautés, en tant qu’espaces affinitaires, peuvent parfois encourager ou renforcer cette dynamique. En général, ça ne finit pas super bien : dérives sectaires, pratiques toxiques… La communauté poussée à son paroxysme n’est pas forcément très reluisante.
Et c’est là que les frontières se brouillent entre communauté (ouverte, inclusive, fluide) et communautarisme (identitaire, fermé, exclusif).
Quand la commu tourne en boucle
Certaines communautés en ligne fonctionnent presque comme des microcosmes fermés : elles ont leur langage, leurs codes, leurs héros… et parfois, très peu de tolérance pour les voix dissonantes. L’effet de groupe peut aller jusqu’à l’exclusion symbolique de celles et ceux qui “ne pensent pas comme nous”, ou ne “rentrent pas dans le moule”.
Exemple : certaines communautés TikTok ultra-codifiées, comme celles autour de la danse ou du lifestyle adolescent, ont été pointées du doigt dans un documentaire Netflix pour avoir nourri des comportements à la limite du harcèlement ou de l’obsession identitaire. Une “commu” où les règles implicites sont si fortes que certains jeunes en arrivent à modifier leur corps ou leur comportement pour exister dans le groupe.
Côté communautés de marque, on observe aussi parfois des dérives, plus subtiles :
- Des marques qui valorisent uniquement les fans les plus actifs, au détriment des profils plus discrets ;
- Des communautés fermées où l’on promeut une vision unique de “ce que c’est d’être un bon membre” ;
- Des stratégies d’engagement qui flattent l’identitaire (look, valeurs, entre-soi culturel) sans créer de vrais ponts vers d’autres univers.
Les exemples sont nombreux et variés. On pense ainsi à certaines communautés tech, centrées sur des produits très “niche” (blockchain, AI, Web3...). Elles peuvent devenir des espaces où l’expertise devient une barrière à l’entrée et où les profils sont de plus en plus homogènes.
Dans certains cas extrêmes, ces dynamiques communautaires peuvent même… virer à la secte. Surtout quand un leader charismatique émerge, que la parole devient unique, et que la critique est bannie. C’est ce qui semble être en train de se passer dans la communauté Don’t Die lancée par l’entrepreneur Bryan Johnson.
Alors, comment éviter cette situation et rouvrir les chakras de votre communauté ? On vous partage 5 pistes de réflexion (et d’action) ci-dessous 👇
Vers un Community Building plus inclusif : 5 bonnes pratiques pour sortir de l’echo chamber
On l’a vu : les communautés ont un potentiel incroyable de lien, d’engagement et de transformation. Mais elles peuvent aussi se refermer sur elles-mêmes. Le rôle du Community Builder, dans ce contexte, n’est pas seulement d’animer, mais aussi de garder la porte ouverte.
Voici cinq bonnes pratiques pour créer des communautés perméables, où l’on cultive l’appartenance sans jamais couper le contact avec l’extérieur.
#1. Inviter des voix extérieures (même celles qui challengent)
Une communauté vivante, c’est une communauté qui accepte le débat, les nuances, les points de vue différents. Et ça commence souvent par une curation intelligente des intervenants.
L’exemple à suivre : dans certains collectifs engagés (féminisme, écologie, tech éthique…), des events sont régulièrement organisés avec des invité·es “hors bulle”. Pas toujours d’accord, parfois venus d’univers très différents… Leur présence empêche la pensée unique de s’installer. C’est le cas notamment de SISTA, qui pour son dernier Summit a réuni des entrepreneurs et investisseurs de divers horizons pour favoriser un écosystème inclusif et diversifié.
À faire chez vous : inviter régulièrement des expert·es, des membres d’autres communautés ou des profils “atypiques” à vos talks, lives ou interviews. Ouvrez l’espace à la confrontation bienveillante.
#2. Créer des formats “ouverts” au-delà des cercles de membres
Tout n’a pas besoin d’être exclusif. Si tout le contenu, toutes les discussions, tous les bénéfices sont réservés aux initié·es, vous risquez de créer un effet club privé — rassurant, mais isolant.
L'exemple à suivre : la communauté de Notion propose des tonnes de ressources accessibles à tous, des événements ouverts et des échanges publics sur Reddit ou Discord. Résultat : on peut se nourrir de la communauté sans forcément être dedans.
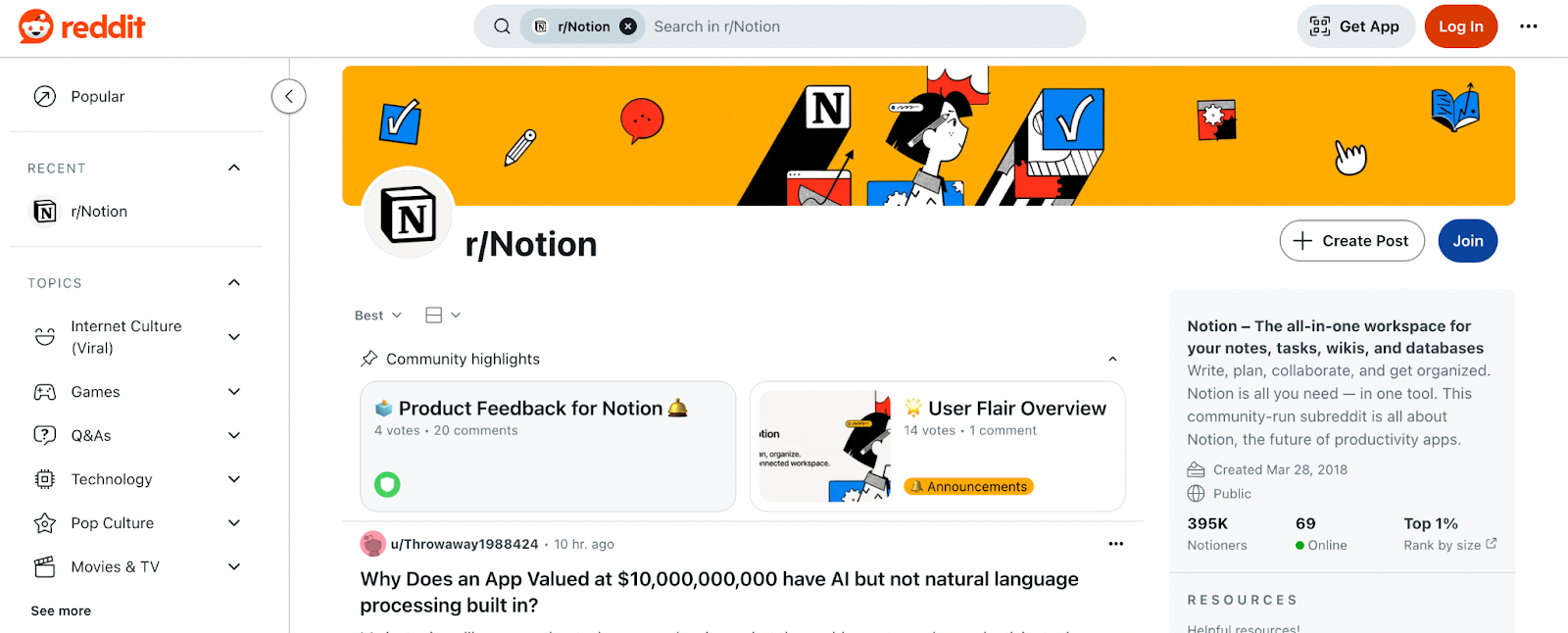
Source : Reddit
À faire chez vous : proposez des contenus ou événements en “semi-ouvert” (par exemple, visibles publiquement, mais interactifs pour les membres), et documentez régulièrement ce qui se passe dans la communauté pour que l’extérieur puisse s’y projeter.
#3. Favoriser les croisements entre communautés
Et si vous arrêtiez de voir les autres communautés comme des “autres” ? Créer des ponts entre univers, c’est une excellente manière d’élargir les horizons de vos membres et de lutter contre la fermeture
.
L'exemple à suivre : certaines communautés ou évènements comme We Love Green ou Komeet (ex-Vendredi) fédèrent des collectifs aux causes très variées (écolo, tech, inclusion, culture…) — et les forcent à sortir de leur zone de confort. Résultat : des rencontres improbables et des idées nouvelles.

Le baromètre de la RSE est co-créé par Komeet et d'autres entreprises partenaires chaque année
À faire chez vous : co-animez un événement avec une autre communauté, proposez une “passerelle” entre vos espaces, ou lancez des formats croisés avec des collectifs aux valeurs compatibles mais pas identiques.
#4. Mettre en lumière les profils marginaux ou minoritaires
Toutes les communautés ont des figures “phares”. Mais ce sont souvent des profils dominants, déjà visibles. Pour éviter la standardisation silencieuse, il est essentiel de diversifier les visibilités.
L'exemple à suivre : dans certaines communautés de gamers, des initiatives comme #BlackGirlGamers ou Gayming Magazine ont émergé pour faire de la place à des voix rarement entendues… et enrichir toute la communauté en retour.
À faire chez vous : identifiez les membres en marge, donnez-leur la parole, proposez-leur des formats d’expression, ou demandez-leur simplement : “Qu’est-ce qu’il vous manque dans la communauté telle qu’elle existe aujourd’hui ?”
#5. Garder une posture de veille et d’auto-évaluation
Aucune communauté n’est totalement à l’abri du repli. Mais une communauté qui sait se poser les bonnes questions, régulièrement, a beaucoup plus de chances d’évoluer sainement.
L’exemple à suivre : certaines communautés d’entreprise, comme Oyomy organisent des “rétrospectives communautaires” pour prendre du recul : qui est représenté ? Qui ne l’est pas ? À qui donne-t-on la parole ? Et pourquoi ?
À faire chez vous : mettez en place une routine d’écoute active (formulaire, sondage, cercle de feedback), et osez prendre en compte les signaux faibles.
Plus votre communauté est vivante, plus elle a besoin de se renouveler et de créer des passerelles vers le monde extérieur. Cette stratégie ne risque pas de l’affaiblir et de diluer le sentiment d’appartenance, c’est au contraire le signe de sa résilience et de sa maturité. Parce que la vraie richesse d’une communauté, ce n’est pas d’avoir tous la même voix. C’est de savoir faire cohabiter plusieurs récits, sans perdre le fil commun.
.png)


.jpg)

